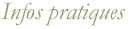Réunissant une cinquantaine d’œuvres iconiques de l’artiste, cette exposition propose de cerner les inspirations qui ont nourri Whistler et de construire un nouveau dialogue entre ses œuvres et celles des artistes de son temps qui ont subi son influence. Une exposition inédite sur le « whistlérisme » qui offre un nouvel éclairage sur l’œuvre et la personnalité insolente de cet artiste américain qui a développé une conception musicale et poétique de la peinture.
Plusieurs fois repoussée pour bénéficier de la présence du plus célèbre tableau de Whistler, Arrangement en gris et noir n°1, 1871 (un portrait de la mère de l’artiste d’une simplicité et d’une grande rigueur de composition), expatrié durant plusieurs années au Louvre Abu Dhabi, la grande exposition « Whistler, l’effet papillon » au musée des beaux-arts de Rouen prend tout son sens dans cette Normandie où il a séjourné en 1865, à Dieppe, puis à Trouville où il a peint et pris des bains de mer avec Courbet. Elle bénéficie de prêts d’œuvres exceptionnelles et de l’aide financière favorisés par la 5e édition du festival Normandie impressionniste dans laquelle elle s’inscrit.
Impressionniste, James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) pourtant ne l’est pas. Certes les impressionnistes sont les amis de cet artiste américain qui a passé l’essentiel de sa carrière entre Paris et Londres, et il a participé au salon des refusés en 1863 avec sa Symphonie en blanc n°1 (sa jeune concubine en tenue blanche virginale, une dépouille de loup à ses pieds) qui a scandalisé le public, mais c’est un indépendant, comme Courbet qui l’influença au tout début. Whistler prendra un chemin différent de son aîné, abandonnant une pâte épaisse et réaliste pour une plus diluée, et une palette de couleurs restreinte. Et ses influences se multiplient. Collectionneur d’art japonais, Whistler s’en inspire, tout comme des maîtres anciens espagnols, notamment Velasquez. À Londres, Whistler s’est mis -comme Monet- dans les pas de Turner. Et il a découvert l’Aesthetic movement né en réaction à la laideur et au matérialisme de l’Angleterre industrielle. On y exprime une beauté simple dans des harmonies de tons et de formes, des atmosphères poétiques, des nocturnes symbolistes, des couleurs comme des notes de musique qu’on assemble pour composer. Alors chez Whistler, les œuvres s’intitulent désormais « Nocturne », « Variation », « Symphonie », etc. Il a trouvé son style, inclassable. Et sa signature, tout aussi originale avec ce papillon aux ailes déployées. Comme les prémices du souffle délicat que provoquera durablement son œuvre.
« L’aura de la peinture de Whistler tient à sa subtile harmonie colorée, à sa grâce et à son mystère, autant qu’à la gamme des sensations qu’elle provoque dans une approche synesthésique en lien, notamment, avec la poésie et la musique. Elle tient aussi à la personnalité hors du commun de cet artiste dandy ayant suscité fracas et scandales », souligne Laura Valette, spécialiste de Whistler à qui elle a consacré sa thèse et co-commissaire de l’exposition. Whistler agace autant qu’il fascine. Il sera même étrillé par le célèbre critique John Ruskin pour sa nocturne représentant un spectacle pyrotechnique (Nuit en noir et or, la fusée qui retombe, 1875) : « Un pot de peinture jeté à la face du public ». Whistler intentera un procès en diffamation contre Ruskin. Ce qui le ruinera…
Mais nombre d’artistes vont le pasticher, s’en inspirer, l’admirer, le réinterpréter (comme l’attestent les multiples déclinaisons qu’Arrangement en gris et noir : Portrait de la mère de l’artiste a inspirées) ou faire son portrait (John White Alexander, Jean Aman, Paul-César Helleu, Boldini, Romaine Brooks, John Singer Sargent, Walter Sickert, Olga Boznanzka…). Jacques-Emile Blanche est l’un des plus intrigués et l’aspect physique de Whistler l’enchante. Whistler est plus qu’un peintre, un graveur et un enseignant, c’est un personnage romanesque, un dandy en parfaite harmonie avec l’effervescence de cette Belle Époque où se côtoient le poète Mallarmé (qu’il a rencontré par l’intermédiaire de Monet), Proust (Whistler fut un des modèles pour le personnage du peintre Elstir dans À la recherche du temps perdu), mais aussi Huysmans, Baudelaire, Théophile Gauthier ou encore Oscar Wilde.
L’exposition d’une cinquantaine de peintures iconiques, dessins et gravures (belle série sur Venise prêtée par la BnF) de Whistler, mis en regard avec des œuvres d’autres artistes (peintures, photographies, gravures, poèmes, extraits littéraires et musicaux…), complétées d’objets d’art (nombreux éventails) et d’objets personnels (canne, palette et boite de peinture de Whistler) invite à une plongée dans l’univers et l’esthétique de Whistler tout en explorant ce que les critiques ont surnommé le « whistlérisme », cette voie singulière au temps de l’impressionnisme, cet impact sur toute une part de la production artistique de son époque.
Le parcours, non chronologique, est divisé en neuf sections thématiques scénographiées comme des salons où l’on respire des parfums et des ambiances. Il ouvre sur un immense portrait en pied caractéristique de la production de Whistler : Rouge et noir : l’éventail, 1889-1896, dévoile ensuite l’effet papillon sur les artistes de son époque, avant d’explorer ses multiples influences et ses cercles de sociabilité. Il se clôt sur les recherches de Whistler sur la disparition de la figure, l’évanescence des formes, la primauté de l’harmonie colorée sur le sujet ; ses nocturnes faisant face à un grand tableau bleu et rouge de Rothko comme une interrogation sur sa contribution à l’abstraction lyrique. Un effet papillon à ne pas trop pousser.
Catherine Rigollet