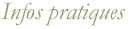L’incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019 a entraîné un chantier de fouilles archéologiques par l’Institut national de recherche archéologique préventive (INRAP) mené par Christophe Besnier, qui a mis à jour de nombreux vestiges, dont 1035 fragments exceptionnels du jubé du XIIIe siècle. Des bustes, mains, pieds, visages, animaux, végétaux provenant de cette clôture de pierre très ornée qui séparait la nef, où se tenaient les fidèles, du chœur réservé au clergé, et qui auraient été enfouis lors de sa destruction au XVIIIe siècle pour répondre aux nouveaux usages liturgiques.
Clou de l’exposition « Faire parler les pierres » au musée de Cluny, une trentaine de ces fragments portant encore des traces de leur polychromie médiévale est exposée actuellement dans l’imposant Frigidarium (salle froide) des thermes antiques dont la voute centrale s’élève à 14 mètres, révélant au passage l’ingéniosité technique des architectes du monde romain. Parmi les pièces les plus belles et émouvantes : une Tête de Christ aux yeux clos d’une grande sensibilité du modelé et de l’émotion (vers 1230).
Depuis sa création, le musée de Cluny est le principal lieu de conservation de sculptures de Notre-Dame de Paris. Inaugurée en 1981, la « salle Notre-Dame » présente les principaux fragments sculptés de la cathédrale déjà découverts. Comme ceux déposés dès le 19è siècle après les campagnes de restauration de Viollet-le-Duc et de Lassus qui avaient mis à jour une quinzaine de fragments du jubé. Tels : Adam et Eve et la chaudière de l’enfer, ou encore un Ange sonnant de la trompe et trois ressuscités sortant de leurs tombeaux. Puis ceux trouvés en 1977 sous un hôtel particulier parisien : plus de 300 fragments, dont 21 têtes de rois de Juda, colossales sculptures extérieures de Notre-Dame, arrachées sous la Révolution française aux cinq grands portails ou à la galerie des Rois, enfouies sous la cour et les écuries. Ces sculptures n’avaient pas été étudiées ni restaurées depuis près de 40 ans. La restauration de la cathédrale et la forte activité scientifique autour de ce chantier ont créé l’opportunité pour le musée de réinterroger ses propres collections.
Aux œuvres habituellement présentées dans la salle des sculptures de Notre-Dame s’ajoutent les pièces du Jubé encore jamais montrées au public. Au total, près de 120 œuvres jalonnent le parcours à la découverte du décor sculpté extérieur et intérieur de Notre-Dame. Des pierres qui nous racontent l’histoire mouvementée de Notre-Dame, rappelant aussi que, comme les cathédrales au XIIIe siècle, elle était peinte de rouge, de bleu, de vert, de jaune et d’or avant que cette polychromie perde de son importance en raison de l’influence de la Réforme protestante et de l’esthétique de la Renaissance (une polychromie conservée à la Sainte Chapelle). Des pierres qui vont continuer à parler car les études se poursuivent ; deux décors successifs ont été identifiés sur le jubé, des réfections ayant sans doute eu lieu dès le Moyen Âge !
Catherine Rigollet