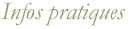D’abord on ne voit que l’homme appuyé sur le mur blanc. Il est à demi-nu, côtes saillantes, le visage tendu, le regard extatique levé vers cette miche de pain qu’une main anonyme et généreuse sortie d’une lucarne tend vers des mendiants qui se précipitent pour s’en saisir. Puis on découvre toute l’horreur de la scène peinte par Gustave Guillaumet (1840-1887) dans un contraste d’ombre et de lumière qui renforce la dramaturgie de la scène : des êtres à demi-morts de faim couchés dans une ruelle. Réalisée en 1868, durant les moments les plus sombres de l’histoire de l’Algérie française, La Famine en Algérie est une toile immense (309 x 234 cm) et emblématique à plus d’un titre. Gustave Guillaumet est l’un des rares artistes français à avoir représenté de manière aussi réaliste les premières années de la colonisation durant laquelle un tiers de la population algérienne périt à cause des épidémies et de la famine, imputables en partie à la sécheresse, mais aussi à la paupérisation des populations rurales dépossédées de leurs terres.
Si Eugène Fromentin a lui-aussi représenté les ravages de la sécheresse dans Le Pays de la soif, Guillaumet se fait plus clairement accusateur. Sa toile sera vivement critiquée lors du Salon de 1869. Guillaumet traité de peintre misérabiliste. Oubliée, fortement dégradée, La Famine en Algérie a été restaurée et constitue l’œuvre phare de cette grande exposition que le musée La Piscine à Roubaix consacre à Gustave Guillaumet, en association avec les musées de La Rochelle et de Limoges.
Considéré comme une figure essentielle de la peinture orientaliste du XIXe siècle, Guillaumet s’en détache pourtant par son regard empathique sur l’Algérie, loin d’un simple attrait pour l’exotisme. Partisan du projet colonial, Guillaumet est aussi lucide sur ses dérives. Son tableau Razzia dans le Djebel Nador, 1864, montre les victimes de ce massacre. Dans l’audacieuse grande huile Le Sahara, dit Le Désert, 1867, Guillaumet peint une carcasse de chameau dans une immensité plate et vide éclairée par une lueur crépusculaire. Un tableau minimaliste qui lui-aussi va sidérer le public.
Guillaumet se rendra plus d’une dizaine de fois en Algérie. Certes, il ne voyage dans le Sud qu’accompagné des militaires, une obligation, mais cet orientaliste engagé ne veut plus y faire de la peinture d’histoire, seule la peinture de genre l’intéresse désormais. Sa fascination pour le désert abyssal et l’observation de la vie quotidienne vont nourrir ses dessins et peintures.
Les campements dans le désert (Campement d’un goum à la frontière du Maroc) succèdent aux bivouacs de chameliers, aux peintures de marchés (Marché arabe dans la plaine de Tocria), aux travaux des champs (Le Labour, frontière du Maroc), aux paysages de séguias, ces canaux à ciel ouvert (La Séguia, près de Biskra), et aux femmes dans les oasis (Laveuses dans l’Oued de Bou Saâda) ou dans les gourbis, ces habitations de terre sèche. Ces « reportages », négociés avec les chefs de famille en lien avec les autorités militaires, sont empreints d’une vision presque ethnographique. Entre 1862 et 1884, Guillaumet va consacrer la totalité de son œuvre à l’Algérie, au désert saharien et à sa population surtout, et lui rendre hommage.
Cette grande et très complète exposition (qui bénéficie de prêts exceptionnels du musée d’Orsay et d’importantes collections internationales) montre tout le talent de ce peintre naturaliste, qui fut aussi pastelliste, graveur et écrivain, et révèle une belle et attachante personnalité.
Catherine Rigollet
– Quatre autres expositions « satellites » de L’Algérie de Gustave Guillaumet sont présentées dans le cadre d’Un Printemps algérien à la Piscine, dont une évocation en portraits et documents d’Abdelkader (1808-1883), héros fondateur de l’Algérie indépendante, qui a inspiré une importante iconographie.
– À voir aussi à L’IMA-Tourcoing l’exposition Photographier l’Algérie.
Visuels : Gustave Guillaumet, La Famine en Algérie, Huile sur toile, 1868. 309 x 234 cm. Constantine, musée public national Cirta (dépôt du musée public national des Beaux-arts d’Alger).
Le Sahara. Huile sur toile, 1867. Salon de 1868. 105 x 200,5 cm. Paris, musée d’Orsay.
Le Labour, frontière du Maroc. Huile sur toile. Salon de 1869. 116 x 165 cm. Limoges, musée des Beaux-arts, dépôt du CNAP.
Tisseuses à Bou Saâda (vers 1882). Huile sur toile, 94,5 x 113 cm. Paris musée d’Orsay.