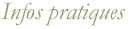Surnommé Lo Spagnoletto, le peintre Jusepe de Ribera (1591-1652) fit toute sa carrière en Italie, poussant le clair-obscur et la dramaturgie du Caravage dans un réalisme cru, féroce et flamboyant. Le Petit Palais retrace l’ensemble de sa carrière en une centaine de peintures, dessins et gravures provenant de musées internationaux.
Avec ses haillons, son visage ridé et son regard triste, ce Mendiant (1612-1614) tenant un béret pour demande l’aumône incarne le réalisme avec lequel Ribera va s’attacher à peindre et restituer la splendeur des humbles, avec une acuité bouleversante et beaucoup d’empathie comme lorsqu’il peint cet enfant au pied-bot, fier et rieur (1642). Et dès le départ, ses portraits de personnages des bas-fonds ou de son environnement proche vont servir aussi de modèles pour exécuter des saints et des apôtres. Qu’il réalisera toujours en séries, comme les grands penseurs qu’il représente en indigents vêtus de haillons.
Dans un parcours chronologique, on suit Ribera de son arrivée à Rome vers 1605-1606 à sa vie à Naples à partir de 1616, alors territoire espagnol. Comme le Caravage, même si rien ne permet de dire qu’ils se sont rencontrés, Ribera pose les fondements de sa peinture. L’usage de modèles vivants pour des portraits d’une frontalité saisissante. Des noirs profonds et de subtils coups de projecteur : ici sur l’épaule et le bras de saint André, là sur un oignon dans une Allégorie de l’odorat. Une gestuelle théâtrale et un réalisme cru.
RÉALISME CRU
Le rendu anatomique est toujours stupéfiant. Poils, cheveux, plis de la peau, veines saillantes et même ongles noircis sont très précisément reproduits (Saint André, vers 1616 - 1618). Il en est de même dans ses natures mortes comme ce livre ouvert au premier plan du tableau de saint Pierre et saint Paul saisis en pleine discussion animée (1616-1617).
Ribera force l’admiration de ses contemporains par sa rapidité d’exécution. En deux jours, il brosse un saint, et en cinq, une grande composition. Les récentes découvertes ont par ailleurs permis d’augmenter le corpus romain de Ribera avec un ensemble de peintures préalablement attribuées au Maître du Jugement de Salomon. Enrichissant son corpus d’une soixantaine d’œuvres magistrales, dont le grand Reniement de saint Pierre (1615-1616).
Naples sera le temps de sa gloire. Marié avec la fille du peintre Bernardino Azzolino, déjà bien établi dans la ville, Ribera est introduit auprès d’une clientèle d’aristocrates locaux et d’ordres religieux. Pour autant, s’il s’impose comme le peintre officiel des vice-rois espagnols et multiplie les commandes religieuses majeures, il demeure le grand portraitiste de la plèbe napolitaine. Son intérêt pour les personnes en marge de la société, se mêle à son goût pour l’étrange, comme ce stupéfiant portrait de Magadalena Venturi, célèbre Femme à barbe (1631) qu’on regarde à deux fois tant le visage et la place du sein de cette femme allaitant interrogent.
VIRTUOSE DU DESSIN
L’exposition met en avant la virtuosité du trait de Ribera en exposant de nombreux dessins et gravures. Il s’y révèle fantasque avec d’amusantes têtes grotesques. Mais en sortant, on gardera surtout en mémoire le somptueux ténébrisme de ses portraits et ses grandes peintures de martyrs de saints au réalisme parfois terrifiant, comme cette scène du Martyre de saint Barthélemy (vers 1616-1617) se faisant écorcher la peau du bras, le visage du saint restant impassible, ses yeux sans larmes, le regard tourné vers nous comme implorant notre compassion. Une image muette mais si puissante de violence et de sons contenus qu’elle convoque bien d’autres sens que la vue. Héritier terrible du Caravage, Ribera s’est bel et bien imposé comme l’un des interprètes les plus précoces, les plus audacieux et les plus extrêmes de la révolution caravagesque, et au-delà comme l’un des plus grands maitres de l’âge baroque.
Catherine Rigollet