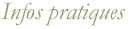Hors des sentiers battus des expositions « médiatiques », le musée Jean-Jacques Henner vit en ce moment une petite révolution dans son calme bourgeois de la plaine Monceau où il occupe l’ancien hôtel particulier du peintre Guillaume Dubufe (1853-1909). L’exposition « Elles. Les élèves de Jean-Jacques Henner », associée à son indispensable catalogue (Faton éditions et musée national Jean-Jacques Henner, 308 pages, 35 €), fait émerger un monde longtemps enseveli, celui des élèves féminines de Jean-Jacques Henner (1829-1905), ce qui par conséquent met en lumière le rôle majeur de Henner comme enseignant. Cet impressionnant travail de résurrection, qui a demandé au moins trois années de préparation à une équipe d’historiennes, de conservatrices, d’universitaires, de chercheuses, a été coordonné par la conservatrice en chef du musée Maëva Abillard, à la fois commissaire scientifique de l’exposition et directrice scientifique du catalogue. Cette exposition commence à écrire une nouvelle page de l’histoire de l’art et participe au salutaire mouvement actuel de redécouverte de la place des femmes artistes au fil des siècles.
En 1874, à une époque où les femmes ne sont pas admises à l’École des beaux-arts - elle ne le seront qu’à partir de 1897 - mais où des ateliers privés se développent pour leur permettre de suivre une formation artistique, le flamboyant Charles Auguste Émile Durant, dit Carolus-Duran (1837-1917), sollicite son collègue et ami, le discret Jean-Jacques Henner, à s’associer avec lui dans son nouvel « atelier des dames » ouvert d’abord boulevard du Montparnasse puis, de 1877 à 1889, quai Voltaire. Les deux peintres sont alors renommés, surtout réputés pour leur talent de portraitiste. Gage de respectabilité pour ces « dames » et leur famille, et pourquoi pas gage d’influence pour une future carrière… Les deux portraits croisés des deux hommes sont d’ailleurs visibles dans la seconde salle de l’exposition au premier étage du musée. Henner reçoit aussi certaines élèves dans son atelier personnel de la place Pigalle et assure des séances de correction dans les ateliers pour femmes d’Hector Leroux et d’Édouard Krug.
L’atelier se dévoile
Alors que le jardin d’hiver du musée affiche notamment la carte des lieux parisiens d’enseignement artistique pour femmes au XIXe siècles et un tableau alphabétique des 152 élèves d’Henner recensées à ce jour, l’exposition commence vraiment quelques marches au-dessus dans le petit salon des colonnes. On y rencontre, dans une galerie de portraits et d’autoportraits, quelques-unes des élèves pour la plupart très méconnues aujourd’hui, hormis sans doute Louise Abbéma, intime de Sarah Bernhardt. Où l’on apprend que certaines des élèves de Henner ont été aussi ses modèles (Dorothy Tennant, Juana Romani, Germaine Dawis, Madeleine Smith). On y voit aussi quelques croquis des élèves et du maître tirés des carnets de dessins de Marie Cayron-Vasselon (1859-1911), très récemment découverts chez ses descendants qui les conservaient. Faute de photographie de l’atelier, ces carnets constituent un vestige inestimable des visages et des gestes de travail des élèves de « l’atelier des dames ». L’essentiel des carnets est consultable sur un feuilletoir tactile dans la cinquième section de l’exposition qui traite des relations entre les élèves.
Au fil des sept sections de l’exposition, qui nous entraîne du rez-de-chaussée au troisième étage dans l’atmosphère cossue de ce typique hôtel particulier de la fin du XIXe siècle, le visiteur découvre la filiation du maître et de ses élèves autour des thèmes de prédilection de Henner, sujets religieux, portraits, têtes de fantaisie, nymphes… Nous apprécions les affinités entre certaines élèves (Ottilie W. Roderstein pose en Jeanne d’Arc pour Madeleine Smith, elle-même peinte par la première devant son chevalet), mais aussi la diversité de leur carrière, entre succès, enseignement et effacement. Jusqu’à sortir de l’oubli fin 2024 grâce à cette exposition pionnière et à son catalogue qui fera date, notamment pour son analyse sociologique des élèves de « l’atelier des dames », ses dix-sept notices biographiques étoffées et son dictionnaire des 152 élèves de Henner dans ses différents ateliers. Une révolution historiographique plus qu’esthétique…
Jean-Michel Masqué