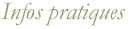Le musée royal des beaux-arts d’Anvers (KMSKA) a rouvert ses portes le 24 septembre 2022 après onze années de travaux de rénovation et de construction. Un superbe écrin pour les 8400 objets d’art conservés au musée, dont 650 œuvres constituent la nouvelle exposition permanente, qui ne bénéficiaient plus depuis des années de conditions optimales d’exposition et de conservation dans ce massif temple néo-classique érigé à la fin du XIXe siècle, au sud du centre historique.
Pas question de toucher à l’ancien bâtiment protégé ; il n’a pu subir que d’importants travaux de rénovation et de nettoyage (stucs, menuiserie, parquets, anciens bancs revêtus de velours rouge, toit…). Les salles de la partie « Maîtres anciens », concentrée au second étage, ont retrouvé leurs murs peints comme à l’origine en rouge antique, vert olive et rouge pompéien tandis que la salle centrale Rubens et Van Dyck retrouvait ses ors. Car Pierre Paul Rubens (1577-1640) est le maître incontesté à Anvers, figure tutélaire de la ville pour son art comme pour ses talents de diplomate et d’entrepreneur. Le dépôt de la collection, autrefois dispersée dans sept endroits différents, a été rassemblé sur deux étages. Ce qui a nécessité la démolition pendant trois mois d’un abri antiatomique au cœur d’un bunker antiaérien, vestiges de la Guerre froide, soit 1350 tonnes de béton et 81 tonnes d’acier !
Pourtant le Musée royal, malgré une apparence extérieure quasi inchangée, n’est plus du tout le même avec l’intégration d’une très importante section « Maîtres modernes » sur plusieurs niveaux. C’est le défi qu’a relevé KAAN Architechten, le bureau d’architectes de Rotterdam dirigé par Dikkie Scipio. Le catalogue nous explique sa démarche : « Au lieu d’opter pour une extension classique, comme une annexe à l’extérieur, elle a choisi la formule de l’« extension intérieure », glissant dans les patios existants, au nombre de six, une nouvelle structure verticale : quatre pieds et, au-dessus du toit existant, une tablette, comme elle la décrit elle- même. Elle a ainsi créé deux mondes en un seul bâtiment. L’ancien musée « horizontal » se présente comme une succession symétrique de salles, alors que le nouveau bâtiment joue surtout sur l’élément vertical et la surprise. Depuis les salles du XIXe siècle, on ne perçoit pas les nouveaux espaces. Pour emprunter les mots de l’architecte : « Le nouveau volume doit non pas entrer en compétition avec l’ancien, mais dialoguer avec lui. » Le musée a gagné 40 % d’espace d’exposition supplémentaire.
DIALOGUE ENTRE ANCIENS ET CONTEMPORAINS
De dialogue, il en est question dès la section « Maîtres anciens », déclinée sur un parcours thématique de vingt-trois salles. « Les Dix » de l’artiste contemporain Christophe Coppens sont dix installations et sculptures imposantes qui ponctuent le parcours en s’inspirant d’un détail d’un célèbre tableau voisin, par exemple un « canapé dromadaire », clin d’œil au monumental L’Adoration des mages de Rubens. « L’intervention “Les Dix”, précise Coppens, est destinée aux enfants mais l’ensemble ne doit pas avoir l’air enfantin et doit également interpeller les adultes. J’y ai vu pour moi une série d’œuvres tactiles, avec du son ou du mouvement, qui stimulent la réflexion et la fantaisie, et poussent les visiteurs à se perdre dans le tableau. » D’autres interférences volontaires font se côtoyer la Madame Récamier de Magritte et Le Mandrill de Kokoschka et des portraits de Rubens, Hals, de Vos ou van Dyck. Si le vénéré maître flamand Rubens occupe la place centrale de cet étage voué aux « Maîtres anciens », une autre œuvre est également mise en exergue, la Madone entourée de séraphins et de chérubins, partie droite du Diptyque de Melun réalisé vers 1450 par le peintre tourangeau Jean Fouquet (1420-entre 1478 et 1481), une toile mystérieuse aux incroyables contrastes chromatiques.
et dont le modèle pour la Madone serait Agnès Sorel, favorite de Charles VII. Dans sa petite salle, cette Madone française au sein d’albâtre est bien entourée par La Sainte Famille au perroquet de Rubens, une Madone à la fontaine de Jan van Eyck (1390-1441) et deux toiles contemporaines (1992) de Luc Tuymans et Marlene Dumas. Toujours ce dialogue entre les siècles qui parfois étonne ou détonne…
LUMIÈRE DE LA MODERNITÉ
Il faut descendre d’un étage pour commencer le voyage vers les « Maîtres modernes », même si, sans souci d’ordre chronologique, il est tentant de s’y jeter dès l’entrée dans le musée puisque la salle inaugurale de cette section moderne et contemporaine se trouve dans le prolongement du hall d’entrée. Seuls deux tableaux emblématiques de la modernité belge y accueillent le visiteur, Le Squelette peintre de James Ensor (1860-1949) et Le Dernier jour de Pierre Alechinsky (1927). Cette salle donne accès aux espaces d’expositions temporaires et à une aile entièrement consacrée à Ensor dont le KMSKA se félicite de disposer de la plus grande collection au monde, au même titre que de l’artiste anversois Rik Wouters (1882-1916), en majesté dans une vaste salle du quatrième étage.
Mais ce qui surprend d’emblée dans cette partie moderne du musée, c’est le blanc des revêtements et la luminosité intense, un contraste absolu avec la partie « Maîtres anciens » à laquelle la profonde restauration a conservé son esthétique XIXe siècle de bois, d’ors, de dorures et de velours dans des couleurs sombres et chaudes. Cette partie moderne n’est pas exempte de gestes architecturaux impressionnants, à commencer par le Stairway to Heaven (sans Led Zeppelin !), un escalier droit et étroit de 103 marches qui fait monter 22 mètres entre le premier et le quatrième étage (un ascenseur est disponible aussi !) où se poursuit l’exposition des modernités, à commencer par la modernité belge. Dans ces salles aussi, scénographiées de façon thématique en lumière, forme et couleur, les siècles se répondent lorsqu’un Saint Ambroise de Fra Angelico vient « flirter » avec un nu de Modigliani…Le nouveau KMSKA est vraiment conçu comme une expérience muséale originale dans une ville qui ne manque pas d’autres hauts lieux.
Jean-Michel Masqué (reportage 2022)