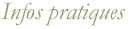À contre-courant de la photographie de rue d’un Walker Evans ou d’une Vivian Maier, Tina Barney (née en 1945 à New York dans une famille de banquiers) a photographié des familles bourgeoises de la côte Est des États-Unis, entre New York et la Nouvelle-Angleterre. Une communauté blanche, en bonne santé physique et financière, photographiée dans ses intérieurs cossus ou dans ses lieux de villégiature, entre déjeuners en famille, anniversaires, mariages, baptêmes, réceptions et barbecues dans le jardin.
« Ce monde est le mien », justifie Tina Barney présente lors du vernissage de son exposition au Jeu de Paume, vêtue ce jour-là d’un pantalon et de baskets grises, loin des tenues chics et guindées de ses modèles. Et comme le faisait Jacques-Henri Lartigue, elle se plait à en saisir les moments de vie, à le documenter. Sans jugement, ni ironie, ni cynisme. S’efforçant d’être aussi impartiale que possible, fidèle à la réalité, suivant en cela l’exemple d’un de ses grands inspirateurs, le photographe allemand August Sander, un siècle auparavant.
Car la photographie, découverte dans son enfance, à la fois avec les clichés de mannequinat de sa mère Lilian Fox, et avec ceux de son grand-père maternel, amateur assidu, est selon elle : « la seule façon de s’interroger sur soi-même ou sur l’histoire de sa vie ».
DÉTAILS, COULEURS ET THÉÂTRALITÉ
On sent que Tina Barney s’adonne avec un réel plaisir à saisir cette vie de l’Amérique mondaine des années 1980-90 (et plus tard en Europe dans le même esprit). Mais elle va au-delà du talentueux cliché familial. Trois caractéristiques dominent son travail : le sens du détail, la couleur et la théâtralité de la composition. À l’instar d’un Jeff Wall, elle guide ses figurants pour donner une dimension théâtrale à la composition proche d’une peinture de chevalet (elle a grandi entourée de tableaux). Le grand format (120 x 150 cm) magnifie les détails des textures et des couleurs, souvent dans une surenchère décorative des tapisseries et des objets. « Je veux qu’il soit possible d’approcher l’image. Je veux que chaque objet soit aussi clair et précis que possible afin que le spectateur puisse réellement l’examiner et avoir la sensation d’entrer dans la pièce ». S’y glissent d’amusants clins d’œil stylistiques. Voulus ? « Parfois le hasard », glisse cette photographe à l’œil affuté. Ainsi, ce bibi tout rond de la femme à gauche dans Réception (1985), qui répond à celui de la statuette sous verre et au motif du tableau en arrière-plan. Les bras croisés du père, de son fils, de la statuette primitive...et en arrière, sur le tableau, cette main posée sur le sein (Les Mains, 2002). Ou encore ces mains sur les hanches de la femme en robe noire reproduisant la pose du grand portrait accroché au-dessus d’elle (Nouveau Mexique, 2003).
L’œuvre de Barney est exposé dans les musées du monde entier, notamment au Museum of Modern Art à New York. Sa série sur les familles a donné lieu à plusieurs expositions en Europe, dont aux Rencontres d’Arles en 2003. Centrée sur son travail essentiellement de portraitiste, l’exposition « Family Ties » retrace 40 ans de la carrière de l’artiste et dévoile une sélection de 55 tirages mêlant clichés de ses débuts et productions inédites, œuvres de commande et personnelles et deux films qu’elle a réalisés, jamais montrés au public.
Catherine Rigollet